Quand réussir une transformation passe par un retour aux fondamentaux
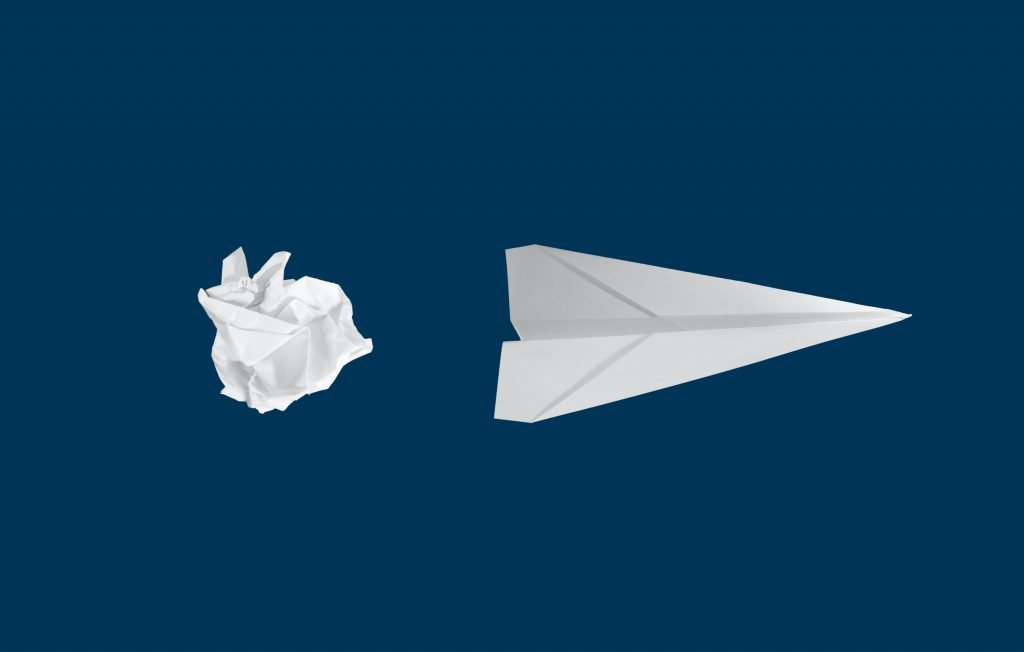
Qu’est-ce qui fait que depuis 20 ans, étude après étude, le taux d’échec des transformations au sein des organisations réussi l’incroyable tour de force de se maintenir entre 60 et 75% ?
L’enjeu est pourtant immense pour les organisations concernées, qu’elles soient en crise ou, tout simplement, qu’elles aient besoin d’adapter leurs modes de fonctionnement afin de satisfaire leurs clients, leurs actionnaires et leurs collaborateurs. Pour y répondre, elles n’hésitent d’ailleurs pas, accompagnées ou non, à engager d’importants moyens, aussi bien humains que financiers, pour lancer et déployer ces programmes de changement ambitieux.
La non-atteinte des objectifs de transformation est moins étonnante qu’il n’y paraît quand on constate que bons nombres d’organisations engagent leur transformation en omettant de tenir compte des bonnes pratiques en la matière.
C’est tout l’objet du fameux « paradoxe de Cobb »[1] : « Nous savons pourquoi les projets échouent, nous savons comment empêcher leur échec, mais alors, pourquoi échouent-ils toujours ? »
Peut-être en évitant juste de tomber dans les pièges habituels.
Savoir pour pouvoir : la connaissance pour l’action
De trop nombreuses organisations conçoivent leur transformation, qu’elle soit culturelle, organisationnelle ou managériale, comme une simple « mise en action ». On parle d’ailleurs de conduire le changement, de le piloter, de le déployer. Transformer est dès lors appréhendé comme un ensemble d’actions et de projets à implémenter.
L’hypothèse derrière cette conception est que les décideurs savent ce qu’il y a à faire. Si l’on est cadre dirigeant, n’est-ce pas parce que l’on connaît bien son organisation, ses forces et ses faiblesses, et ce qu’il convient de faire ? D’ailleurs un cadre dirigeant n’est-il pas rémunéré pour cela ?
Comme le souligne François Dupuy (On ne change pas l’entreprise par décret, 2020), cette conception est erronée. Les décideurs confondent connaissance ordinaire et connaissance élaborée. En tant que parties prenantes d’une organisation, ils sont en mesure d’observer, de leur place, un certain nombre de phénomènes et de se faire une certaine idée du fonctionnement de leur organisation. Et encore, avec leurs propres filtres et ceux de leur organisation (remontée parcellaire des informations, ouverture de parapluies…). Cela est cependant insuffisant pour constituer une connaissance « élaborée » permettant d’agir savamment tant les univers organisés sont complexes et peu déchiffrables à l’œil nu. Pour les décoder, il est nécessaire de mobiliser un appareil conceptuel et une méthodologie adaptés.
C’est notamment le rôle du diagnostic (cf. notre article le diagnostic en coaching d’organisation) qu’il soit culturel ou sociologique, de poser un regard amont sur le fonctionnement réel de l’organisation. Ceci afin, d’une part, de comprendre ses mécanismes profonds et ses jeux de pouvoir, d’autre part, d’identifier ses zones de progrès et leviers de transformation possibles. Savoir pour pouvoir, ou « comprendre pour entreprendre », implique que toute démarche de transformation intègre comme jalon fort une étape de diagnostic de la situation afin de ne pas confondre symptômes et (vrai) problème.
Car ne nous trompons pas, la transformation débute, et son succès se dessine, dès la première mise en mouvement de l’organisation.
Prioriser les initiatives : poursuivre un seul lièvre à la fois
Beaucoup de consultants vantent les mérites d’une approche qualifiée « d’holistique » où tous les chantiers, des plus simples aux plus complexes doivent être menés de front. La transformation est conçue, et vendue, comme nécessairement globale et multi-dimensionnelle.
L’expérience montre qu’une telle approche n’est pas forcément la plus performante si elle passe par le fait d’embrasser toutes les composantes de la transformation en même temps. Vouloir poursuivre plusieurs objectifs majeurs simultanément – faire évoluer les pratiques managériales, bouleverser la structure formelle, réviser la stratégie, changer de système d’information, etc. – est risqué à plusieurs titres. D’abord, parce qu’une telle stratégie rend difficile pour les salariés la compréhension du cap de la transformation voulue. Ensuite, parce qu’elle créé une impression de mouvement désordonné, voire anarchique, susceptible de renforcer l’anxiété chez les salariés. Enfin, et surtout, une telle démarche épuise managers et collaborateurs, alors confrontés à un phénomène de « saturation au changement ». Sans parler des traces laissées dans l’esprit des collaborateurs ces fameux deux tiers de projets de changement avortés, tronqués…
L’accumulation, surtout sur un temps long, de projets tous azimut favorise stress et anxiété avec des phénomènes de retrait et de désengagement contraires au besoin de large implication de tous dans le changement.
L’approche holistique s’avère utile dans son aptitude, pour les pilotes et accompagnateur d’une transformation, à considérer la globalité des champs d’intervention, des problématiques à résoudre. Le risque, encore une fois, est le « en même temps » ! Avancer pas à pas, étape après étape, chantier après chantier, est généralement bien plus efficace à partir du moment où la démarche s’inscrit dans une compréhension globale et un sens commun. Les fondations de la transformation sont plus solides, la communication sur les « premiers » résultats obtenus, les petites « victoires » chères à Philippe Silberzahn[2], plus efficace, le sens des priorités mieux affirmé.
Prendre appui sur un noyau moteur : disposer d’une coalition
Une transformation est également affaire d’essaimage. Communiquer et échanger sur le sens et les modalités du changement avec les équipes sont des préoccupations légitimes. Lancer une plateforme digitale d’animation et d’accompagnement du changement dédiée à l’engagement des collaborateurs peut aider. Mais l’élément clé reste d’impliquer les personnels dans le processus de changement. Or, le baromètre « Human Transformation Index » d’Akoya souligne en 2021 que seulement 45% des entreprises associent correctement leurs collaborateurs à leurs processus de transformation[3].
L’avantage d’impliquer correctement ses collaborateurs ? Tout simplement créer une coalition d’acteurs apte à soutenir le projet. Appelé « réseau d’agents du changement » ou « communauté d’ambassadeurs », un tel dispositif agrège autour des commanditaires un noyau de managers et de collaborateurs, fonctionnant de façon collaborative et autonome, au service de la transformation attendue. Il agit comme un « 3ème pouvoir », aux côtés de l’action de l’équipe de direction et de la ligne managériale, pour l’animation et le soutien au processus transformationnel.
Savoir être collectivement efficace : coconstruire les meilleures solutions
Dans une conduite de projet classique, dite « en cascade », la phase de conception est trop souvent restreinte à un petit nombre de personnes. Les collaborateurs sont considérés au mieux comme des utilisateurs, au pire comme des cibles. On leur demande d’exécuter, sans discuter, les bonnes décisions prises au sommet en matière d’organisation-cible ou de nouveaux modes de fonctionnement. Cette approche ne facilite guère le sens des responsabilités et l’engagement de tous. Elle peut au contraire aboutir à des stratégies de retraite, d’apathie, de résistance, voire de sabotage.
Sans tomber dans l’autogestion ou de grands débats sans fin, il s’agit d’introduire, à des moments clés de la démarche de transformation des occasions d’associer largement le corps social à la réflexion et à la coproduction de solutions concrètes et opérationnelles. Tout n’est pas permis. Le processus collaboratif est cadré et les thématiques à travailler sélectionnées pour leur impact opératoire. Les modalités de la co-construction déjà évoquées dans notre article L’intelligence collective « augmentée » au service de la transformation des organisations sont des plus variées. de l’organisation d’ateliers participatifs à l’utilisation d’une démarche de Design thinking, elles permettent, collectivement de clarifier les besoins, de la créativité, de prototyper, puis expérimenter en mode « test & learn ».
S’appuyer sur l’intelligence collective est une façon, pour les pilotes du changement, de renforcer la solution, de s’assurer qu’elle n’est pas uniquement la meilleure sur le papier, mais la plus adaptée aux besoins de l’organisation. Cela suppose du lâcher prise et du courage managérial, qui ouvrant la voie à des résultats qui iront au-delà des attendus. Au plan, individuel, les collaborateurs deviennent actifs et comprennent le sens du changement. Au plan collectif, la phase de conception s’en trouve peut-être allongée, mais la phase de déploiement en devient bien plus solide et sécurisée, voire parfois facilité.
Imposer un rythme soutenable : ralentir pour aller plus vite
La vitesse est souvent considérée comme un impératif indépassable. Les programmes de transformation sont souvent élaborés pour mener à bien le changement de façon effrénée. Il faut aller vite, pour faire mieux que ses concurrents et revenir dès que possible à un mode de fonctionnement nominal plus acceptable. Toute forme de procrastination est bannie.
Si, comme l’a montré John Kotter[4], il peut être pertinent, dans certains cas, de créer un « sentiment d’urgence » pour enclencher le changement, vouloir aller vite peut s’avérer contreproductif. Il peut être difficile de mobiliser en interne suffisamment de ressources. Cela peut générer un sentiment de maelström, de tourbillon, de frénésie, source de profondes inquiétudes. Difficile alors de se poser, de prendre le temps de la réflexion et, surtout, de pouvoir ajuster le process de changement pour tenir compte des aléas ou des résistances. Dans son ouvrage La force des discrets, Susan Cain montre à quel point notre monde occidental, surexcité, gagnerait à ralentir le rythme[5]. Il en est de même dans les organisations. Si les résultats d’une transformation sont mesurables entre 18 et 36 mois, vouloir les attendre au bout de 6 ou 9 mois est illusoire.
Pour garder un bon rythme, il faut commencer par imposer des limites et des objectifs atteignables. Dans une logique de « slow change », il est préférable de se fixer des objectifs moins ambitieux mais in fine réalisables. Ralentir, pour aller plus vite, permet de digérer les informations qui proviennent de l’extérieur ou de l’interne, d’être à l’écoute des besoins de l’organisation et de ses collaborateurs, de changer de cap si nécessaire, de maintenir à minima son organisation en équilibre.
Le bon sens en action
Ces bonnes pratiques, qui sont affaire de bon sens, sont souvent les grandes oubliées des démarches de transformation organisationnelle. Savoir pour pouvoir, prioriser les initiatives, prendre appui sur un noyau moteur, savoir être collectivement efficace et, enfin, imposer un rythme soutenable devraient constituer les cinq incontournables de tout processus de changement. Seule l’activation conjointe de ces leviers peut permettre la réussite d’une transformation et sa pérennisation pour des résultats opérationnels probants.
Article co-écrit par Jean-Yves Guillain et Vincent Minaud – co-fondateurs du Transfo’LAB et experts en accompagnement des transformations d’organisation
Suivez l’actualité de notre page LinkedIn pour vous tenir au courant de la publication de nouveaux articles
[1] Voir Lynda Bourne, 2011, sur https://pmhut.com/project-failure-cobbs-paradox et l’article du Standish Group https://www.inf.ufpr.br/urban/2019-1_205_e_220/205e220_Ler_ver_para_complementar/StandishGroup__UnfinishedVoyages-I.pdf
[2] Philippe Silberzahn, Effectuation, Pearson, 2ème éd., 2020.
[3] https://akoya.group/perspectives/barometre-human-transformation-index-2021/
[4]John Kotter, A Sense of Urgency, HBR Press, 2008.
[5] Susan Cain, La force des discrets, Lgf, 2014.


